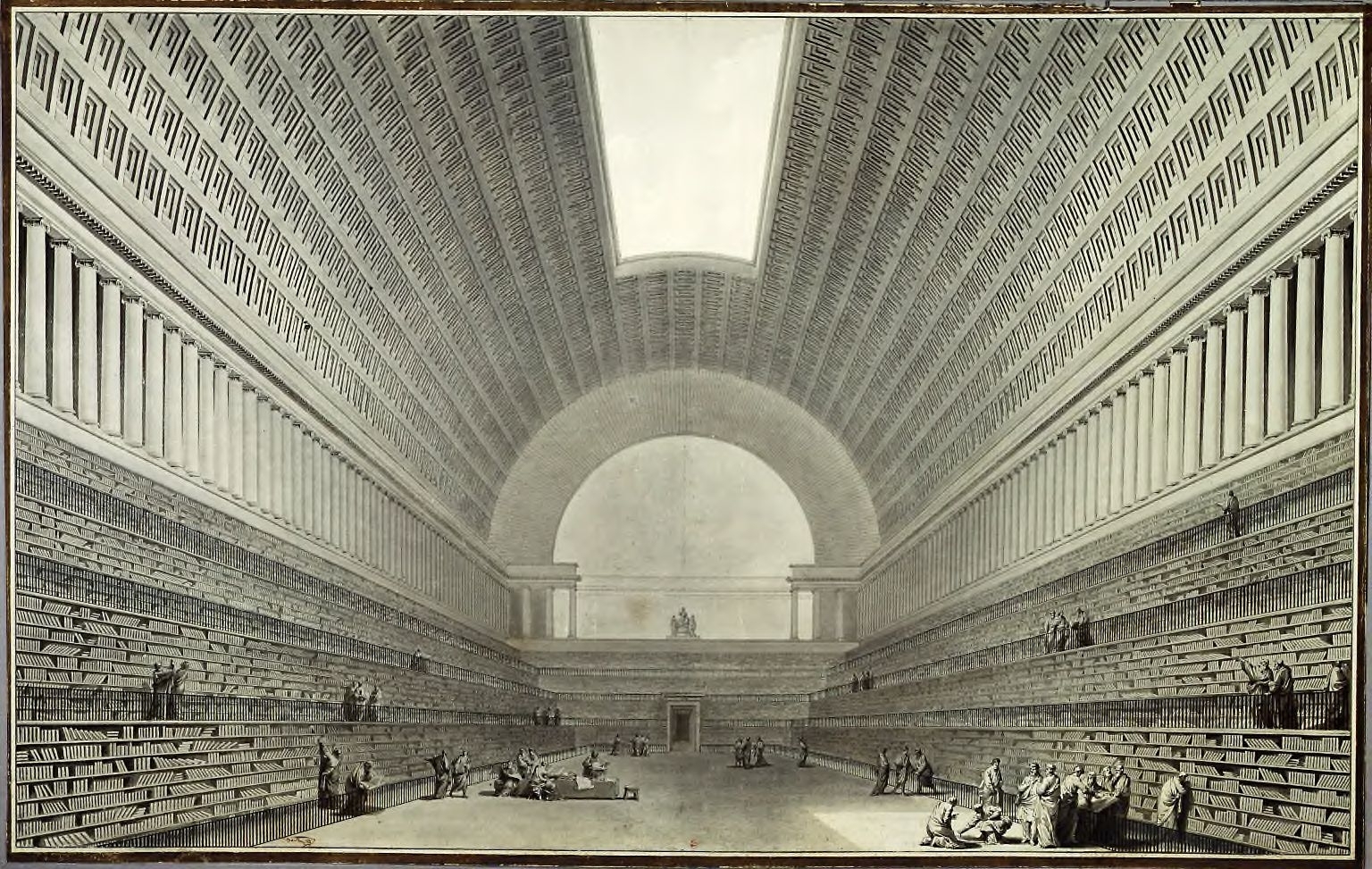Boutaric, Edgard. « Le Vandalisme révolutionnaire. Les archives pendant la Révolution française ». Revue des Questions Historiques no Septième année (1 octobre 1872): 325‑396.
Cette publication a pour but « de constater les documents historiques qui ont péri ». D’après E. Boutaric, les études sur les destructions n’étaient pas complètes au moment qu’il écrit. Il entreprendre de décrire, dans un ton souvent ironique, les lignés générales. Sa procédé est un exemple du positivisme historique. Il ne veut pas faire un choix entre les opinions divergentes, mais il veut plutôt faire recours « aux sources originales (si elles existent), les comparer, les presser et leur faire dire ce qu’elles disent, rien que ce qu’elles disent (p. 326) ».
Quoique Boutaric prétend faire un étude neutre, son style est souvent accompagné de commentaires dérisoires vis-à-vis les événements révolutionnaires. Ainsi, il pousse — assez consciemment — le lecteur vers une prise de position politique contre la Révolution. Les révolutionnaires apparaissent, en général, comme des barbares destructeurs d’oeuvres d’art et, dans son cas, des archives. Quelques érudits, membres des commissions chargées de la préservation des monuments d’art, faisaient l’exception : par exemple Gaston Camus, le premier directeur des Archives nationales, et l’abbé Poirier. Cependant au moment d’analyser la situation des archives ecclésiastiques sur Paris, en ce qui concerne les archives ecclésiastiques il arrive à la conclusion que « il n’y a guère qu’à louer : presque tout a été sauvé », ou sur l’abbaye de Saint-Denis « Rendons justice à qui de droit : non-seulement l’agence et le bureau du triage des titres, mais encore la municipalité de Saint-Denis et l’administration du district de Franciade, prirent les mesures les mieux entendues pour préserver cette magnifique collection ».

Hubert Robert, La violation des caveaux des rois dans la basilique de Saint-Denis en octobre 1793, Musée Carnavalet
Cependant, à cause de la méthodologie employée, Boutaric tombe exactement sur ce qu’il veut éviter. On le verra plus loin, il signale comme un erreur le fait que d’autres historiens font seulement recours à certains documents, mais lui-même fait la même opération, certes avec un corpus documentaire différente, mais il ne va plus loin, et il ne mentionne non plus des vérifications sur place des destructions rapportées dans ses sources.
Cet article est divisé en quatre parties : une Introduction (p. 325-337), où il expose une sorte d’état de la question ; une « Histoire des mesures générales prises de 1789 à 1800 pour conserver ou détruire les anciennes archives » (p. 338-365), suivie d’un résumé des « Destructions opérées à Paris » (p. 365-396), et annonce pour une autre occasion les « Destructions opérées dans les départements ».
Boutaric constate que dans ses célèbres Rapports sur le vandalisme, l’abbé Grégoire néglige de mentionner les archives. Boutaric affirme que cela est dû au fait que Grégoire et « ses pareils » considéraient que les documents « concernaient un passé dont il fallait faire disparaître le souvenir » (p. 327).
La première partie de son travail est consacrée à l’historiographie qui s’était penché jusques là au vandalisme dans les archives. Dans un rapport sur l’organisation des archives départamentales, adressé au roi Louis-Philippe en 1840, le ministre de l’Intérieur Tanneguy Duchâtel affirme que les destruction opérées par la Révolution n’étaient si étendues comme on le croyait (p. 328). Vallet de Viriville, dans un article du 4 octobre 1854 dans Le Moniteur Universel, était de la même opinion, ainsi que l’écrivain Henri Bordier, dans son oeuvre Les Archives de la France de 1855.
Bordier argumente que les Archives nationales conservent plus de quinze mille procès-verbaux, dont seulement soixante-quatre font mention de brûlements d’archives (p. 328-329). Cependant, Boutaric retorque que ces documents ne sont pas antérieurs au 10 août 1793 et que les brûlements ont commencé en juin 1792. En suite, il remarque que tous les adresses ne sont pas les sources appropriées pour documenter la destruction des archives, car il s’agit de pièces qui servent aux clubs ou aux particuliers pour se faire remarquer. Par contre, des procès-verbaux officiels existent dans les archives des préfectures et des départements (p. 330).
À Vallet de Viriville, Boutaric reproche que dans un article publié deux jours plus tard par le gouvernement, fait le constat des parchemins trouvés lors de l’examen des gargousses au dépôt d’artillerie. D’après Boutaric, on aurait trouvé 1200 pages de la comptabilité royale depuis Charles VI, 200 pièces de la chambre des comptes du Dauphiné remontant au XIIIe siècle ; 700 chartes de l’église de Meaux, 500 pièces d’archive de l’Artois, de la Flandre et budgets de villes remontant au XIVe siècle, etc. (p. 331). Cependant, il n’est pas claire de l’article si ces documents ont été transformés en gargousses pendant la Révolution, au temps de Viriville ou au temps de Boutaric lui-même.
En suite, Boutaric s’arrête sur le rapport rédigé par Félix Ravaisson (Rapport adressé à S. Exc. le ministre d’Etat, au nom de la commission instituée le 22 avril 1861), adressé au ministre Walewski en 1860, à propos des archives de la République. Ravaisson avait été chargé d’étudier la question des documents que devaient échanger la Bibliothèque Impériale et les Archives nationales (p. 332) ; et l’introduction du marquis de Laborde à l’oeuvre de Jules Tardif (Monuments historiques. Paris: Impr. de J. Claye, 1866, 711 p.), publiée plus tard dans un volume indépendant sous le titre (Paris: Vve Renouard, 448).

Ecole française, Alexandre Lenoir (1761-1839) défendant les monuments de l’abbaye de Saint-Denis contre la fureur des terroristes, dessin, Musée du Louvre
Le rapport de Ravaisson a l’avantage qu’il reproduit plusieurs documents intéressants pour l’histoire du vandalisme dans les archives. En particulier, le mémoire de Camus sur les dépôts de chartes, registres, documents et autres papiers qui existaient dans le dépôt du département de la Seine, et sur leur état à l’époque du 1er janvier 1789, sur les révolutions qu’ils ont éprouvées et sur leur état au 1er nivôse de l’an VI. Boutaric contraste le « plaidoyer passionné contre la Révolution » de Laborde avec le mémoire de Camus, « froid, sec, sans vie », mais « plus probant pour un esprit attentif, avec sa rigueur mathématique ».
De l’examen de sources et des lois, Boutaric distingue quatre catégories de destructions d’archives (p. 337) : destructions pendant une émeute populaire ou de la négligence des administrations ; brûlement officiel par ordre de la Législative ou de la Convention ; triage inintelligent et malveillant et fabrication de gargousses ou cartouches. Il mentionne les lois du 16 mai 1792 sur la destruction des archives déposés au couvent des Augustins, celle du 24 juin 1792 sur la destruction des lettres généalogiques ; celle du 19 août sur l’apurement des archives de la comptabilité ; la loi du 15 janvier 1793 sur l’usage des parchemins dans des gargousses et encore d’autres (p. 347-351).
Un aspect intéressant de l’article est la reproduction de quelques rapports jusqu’alors inédits. Le rapport du 25 juillet 1793, rédigé par Poirier au nom de la Commission des monuments et adressé au Comité d’instruction publique. Dans ce rapport, Poirier fait preuve d’ingéniosité car il essaie de se montrer à la fois révolutionnaire et souligner l’importance des documents :
Parmi ces actes et ces registres qui font mention de droits que la Convention vient d’abolir, il y en a beaucoup que leur ancienneté rend précieux par ce qu’ils contiennent de relatif à l’histoire, aux moeurs et aux usages des siècles qui nous ont précédés, aux dates, à la géographie et à la topographie de la France, au glossaire de notre ancienne langue, à la paléographie et à la diplomatique, au prix des denrées et à la valeur de la monnaie, aux poids et mesures, au commerce, à l’agriculture et aux arts, tous objets sur lesquels il reste encore bien des éclaircissements à obtenir et que le rapprochement des anciens monuments, jusqu’ici ensevelis dans la poussière des archives, peut seul nous procurer (p. 351).
Pour Boutaric, ici se trouve une des raisons par laquelle la Commission des monuments a été finalement supprimée car « Le gouvernement trouva surtout mauvais le soin avec lequel la commission cherchait à conserver les registres de la chambre des comptes ». En effet, la commission serait supprimée peu après, le 4 frimaire an II [24 novembre 1793] (p. 353).
Dans le chapitre consacré aux destructions opérés sur Paris, Boutaric fait l’énumération des archives vandalisés. Il les classe en trois :
I. Archives politiques, administratives et judiciaires
- Archives de la Bastille
- Trésor de chartres
- Cabinet du Saint-Esprit
- Maison du Roi et ministère de la maison du roi
- Chancellerie de France
- Ministère de la guerre et des affaires étrangères
- Conseils du Roi
- Conseil de Lorraine
- Parlement
- Chambre de Comptes
- Hôtel de Ville de Paris
- Université et écoles
II. Archives ecclésiastiques
III. Archives privés (émigrés et condamnés à mort).
Boutaric n’a pu continuer ses études car il est décédé en 1877, à 48 ans, après deux ans de maladie. À la fin de cet article on trouve les deux remarques que je considère les plus utiles. Il affirme que pour les vandales révolutionnaires, « plus ce passé [l’Ancien Régime] était voisin, plus il paraissait odieux (p. 396). Et nous sommes d’accord avec lui sur le fait que le vandalisme n’a rien d’irrationnel. Sur les brûlements de documents sur la place Vendôme il affirme que ces titres ont été « choisis avec une barbarie intelligente » (p. 396).

Les têtes des rois provenant de la galerie des rois de Notre-Dame de Paris, et exposées au Musée du Moyen-Âge. Photo: Julien Danielo. Source
Pour savoir plus :
- BORDIER, Henri, Les Archives de la France, ou histoire des archives de l’Empire, des archives des ministères, des départements, des communes, des hôpitaux, des greffes, Paris, Du Moulin, 1855
- —, Les archives de la France, leurs vicissitudes pendant la Révolution, leur régénération sous l’Empire, Paris, Vve. Renouard, 1867
- CAMUS, Mémoire sur les dépôts de chartes, registres, documents et autres papiers qui existaient dans le dépôt du département de la Seine, et sur leur état à l’époque du 1er janvier 1789, sur les révolutions qu’ils ont éprouvées et sur leur état au 1er nivôse de l’an VI, dans RAVAISSON, Felix
- DESPOIS, Eugène, Le Vandalisme révolutionnaire, fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la Convention (Paris, Germer-Baillière, 1868)
- RAVAISSON, Felix, Rapport adressé à S. Exc. le ministre d’Etat, au nom de la commission instituée le 22 avril 1861, Paris, typographie Panckoucke, 1862, 371